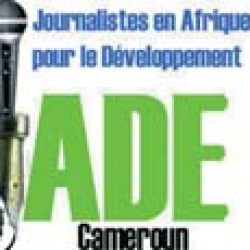Sans travail et enfermés dans des camps militaires.
Ils sont déjà plus de 300 à avoir répondu à l’appel du chef de l’Etat d’abandonner les armes. Mais l’incertitude au sujet de leur réintégration sociale inquiète. Les promesses gouvernementales piétinent concernant, notamment, leur formation aux différents métiers. Les ex-combattants vivent aujourd’hui comme des prisonniers.
Le samedi 20 Mars. Faï Yengo Francis, le coordonnateur national du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants ( cnddr), préside la cérémonie de pose de la première pierre de construction du centre d’accueil des ex-combattants séparatistes anglophones à Tiko, dans la région du Sud-Ouest.
D’un coût de 1,5 milliards de fcfa, l’infrastructure va accueillir plus de 300 anciens combattants anglophones qui ont déposé les armes, et leur offrir des formations dans les domaines variés comme l’agriculture, l’élevage, la couture, l’informatique. Le lancement de projets similaires s’est déroulé, il y a 3 ans, dans les villes anglophones de Bamenda et de Buéa.
Pourtant aujourd’hui, les ex-combattants n’ont toujours pas de travail et s’inquiètent de leur statut. Sont-ils encore des hommes libres ? Puisqu’ils sont gardés par la police et des militaires lourdement armés. Tous leurs mouvements sont contrôlés.
Le vendredi 19 mars, veille de la cérémonie de Tiko, une vingtaine d’anciens combattants séparatistes anglophones, fatigués d’attendre la mise en application du projet de socialisation prôné par l’Etat, ont organisé un mouvement de protestation à Buéa, dans un camp militaire où ils sont gardés. Ils ont bloqué des routes des quartiers Long street à Bokwoango, et érigé des barrières sur la voie publique.
Approchés, certains affirment qu’ils sont dans des bases militaires depuis plus de deux ans. Ils ne peuvent pas sortir. Ils n’ont pas de carte nationale d’identité. Et ils n’ont pas de travail. Ils exigent que l’Etat leur accorde les formations aux petits métiers promis au départ.
« Ils nous ont identifié lorsque nous sommes arrivé ici. Ils ont dit que le mois qui suivait, on devait avoir nos cartes. Jusqu’à aujourd’hui, rien. Nous sommes nourris ici. Mais est ce que nos enfants mangent ? Comment vivent nos femmes ? Qu’ils nous donnent des formations comme ils ont promis pour nous permettre d’aller travailler. Nous sommes fatigués d’être prisonniers ici», affirment les anciens combattants anglophones. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest descendu sur les lieux leur a promis de parler de leur situation au coordonnateur du cnddr, et il viendra les voir.
Les ex-combattants Boko-Haram également aux abois.
Moudou Oumarou 35 ans est un ex-combattant de Boko-Haram. Comme les 200 autres anciens membres camerounais du groupe djihadiste nigérian, ils sont rentrés volontairement à pied du Nigeria voisin et se sont rendus aux autorités des villes de Kolofata et de Mémé, des villages camerounais, frontaliers au Nigeria.
Ils ont été amenés à la base de la Force mixte multinationale (FMM) situé à Mora dans le département du Mayo Sava dans la région de l’extrême-nord, lieu de « recasement » des ex-combattants démobilisés. La base a été mise en place par le Nigeria, le Cameroun, le Tchad et le Niger pour conjointement lutter contre la secte islamique Boko-Haram, un mouvement né au Nigeria mais qui opère régulièrement dans ses trois pays frontaliers.
Moudou Oumarou passe la journée assis sur un tronc d’arbre. Il affirme avoir rejoint les rangs de Boko-Haram, parce qu’on lui avait promis un avenir meilleur pour lui, ses trois femmes et ses 12 enfants. « J’ai participé aux nombreux pillages avec Boko-Haram, nous avons brûlé des maisons et tué des gens. Mais plus le temps passait, plus je constatais qu’ils ne me donnaient pas ce qu’ils m’avaient promis. Quand l’Etat du Cameroun nous a tendu la main j’ai jugé bon de retrouver le chemin de la paix, d’abandonner la secte », précise Moudou.
Mais il est inquiet au sujet de sa resocialisation. « J’ai de nombreux enfants, directement on ne nous propose rien pour gagner de l’argent. Il faut attendre les promesses du gouvernement. Et tout va très lentement. Nous sommes très inquiets. Beaucoup d’entre nous risquent de commettre des vols dans la ville », indique-t-il.
Ahmadou, un autre ex-combattant qui fait partie de la première vague à être arrivée à la FMM ne cache plus son inquiétude. « Ils ne nous disent pas s’ils vont nous apprendre les métiers qu’ils nous ont promis ou même nous intégrer dans l’armée. Ils nous parlent seulement des camps qu’ils vont construire pour nous mettre à l’intérieur. Ce qui nous intéresse c’est ce qu’on va faire pour retrouver une vie sociale normale ».
En effet pour encourager les ex-combattants à sortir de la brousse, l’Etat a promis de leur offrir des formations. Depuis plus de 4 ans. Aucune promesse n’est tenue.
Problème d’insécurité dans les villes
Les habitants de Mora, Bamenda et Buéa ne cachent pas leurs inquiétudes. Certains ex-combattants selon eux, regagnent directement leurs familles et commettent des exactions ou des vols avant de revenir dans les centres d’accueils. Beaucoup se dissimulent au sein de la population, commettent des attaques qu’on attribue à Boko-Haram ou aux séparatistes anglophones. Les populations craignent que ces ex-combattants s’échappent de la base pour commettre des vols puisqu’ils ont besoin d’argent. Le gouvernement ne leur en donne pas pour le moment.
Maigre ration alimentaire
Il y a trois ans, le chef de l’Etat a offert un don de 21 million de fcfa. Mais les ex-combattants de la secte islamique comme tous les autres sont pour le moment obligés de se contenter d’une ration alimentaire qu’ils jugent très maigre, distribuée au camp militaire. Ils consomment les conserves accompagnées des repas locaux cuisinés à l’intérieur de la base. Venus d’horizons différents, beaucoup qui découvrent ces types de repas seulement pour la première fois ont du mal à digérer.
Sans infrastructure ni personnel, la Coordination nationale en charge du désarmement de démobilisation et de réintégration des ex-combattants en zone anglophone est faible, et ne présente aucune garantie pour l’avenir de ces centaines de personnes.
Et même s’ils sont déçus par l’Etat, ils ne pourront plus faire marche arrière parce qu’ils seront abattus par leurs anciens camarades de guerre pour trahison. Certains, discrets, affirment regretter même le fait d’avoir rejoint le camp de la base militaire.
Ils nous montrent les photos de leurs femmes et de leurs enfants qu’ils ont abandonnés dans des villages lointains sans nouvelles depuis plusieurs années. « Nous sommes des pères, nous ne savons même plus si nos familles sont encore en vie. Quand nous désertons les rangs de Boko-Haram, ils peuvent aller massacrer nos familles pour nous faire du mal », s’inquiète Oumarou, chapelet en main.
Les lois internationales protègent pourtant ces ex-combattants. Le pacte international relatif aux droits sociaux et culturels annonce que « Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu’a toute personne d’obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté, et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit ». En respect de cette convention, l’Etat doit agir.
Hugo Tatchuam (Jade)