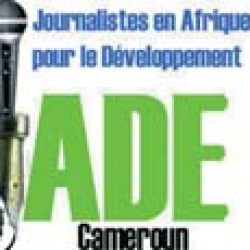Ils exigent que le maire enlève les scellés sur leurs boutiques à l’entrée du marché A de la ville. Samuel Fondop, promoteur du Cispam pense que le maire de la commune de Dschang est en marge de la légalité.
Les relations entre la commune de Dschang et le centre des aveugles et déficients visuels de la localité sont tendues. Le mercredi 08 février dernier, des jeunes aveugles ont fait un sit-in à l’entrée de cette municipalité. Nargués par le troisième au maire de cette commune qui ne voulait pas examiner favorablement, leurs doléances, ils ont maintenu leur mouvement au point que les scellés posés sur les deux boutiques où ils exposaient leurs produits artisanaux soient enlevés sur ordre du Maire, Mkemleu.
En effet, durant deux semaines et plus les boutiques n° 6 et 25 du marché A de Dschang ont été sous scellés. Ces boutiques sont gérées depuis plus de quarante ans par le Centre des Jeunes Aveugles de Dschang. Notre confrère, Menoua Actu, fait savoir que c’est dans la boutique n° 6 que les produits artisanaux fabriqués par les pensionnaires du CJAD dans leur atelier professionnel sont exposés. La boutique n° 25 quant à elle est un bar où les non-voyants accompagnés de leurs encadreurs apprennent à vendre la boisson. Approché par Journalistes en Afriques pour le développement(Jade), Samuel Fondop, responsable du centre d’intégration scolaire et professionnelle pour aveugles et malvoyants (Cispam) juge indigne l’attitude du maire de la commune de Dschang.
Il partage l’avis suivant lequel, « ce sont les revenus de ces deux boutiques qui renforcent la ration alimentaire de ces enfants handicapés visuels issus pour la plupart des familles démunies. » Toujours dans l’optique de subvenir aux besoins primaires des jeunes non voyants, les responsables du Cejad ont positionné devant l’une des deux boutiques une station de « baby-foot » qui fonctionne en journée et dont les revenus sont redistribués à ces jeunes déficients visuels en guise d’agent de beignets.
A lire la demande d’exonération des frais locatifs de ces boutiques adressée au Maire de la commune de Dschang le 31 mai 2021, il ressort que c’est le maire Nguetsa Pascal qui, en 1975, va décider de mettre la boutique n°6 à la disposition du CJAD comme contribution de la municipalité à l’encadrement ainsi qu’à la restauration de ces enfants
en plus de la subvention annuelle de 150 000 frs qu’elle lui reversait. Quant à la boutique n°25, souligne Menoua Actu, elle a été construite par le CJAD sur un espace offert par feu Dr Panka Paul qui succéda au Maire Nguetsa. L’objectif étant d’accroitre les revenus du centre reconnus résiduels par le magistrat municipal et le rendre plus
autonome.
Il est donc demandé au Centre des jeunes aveugles de Dschang de verser 20 000 francs Cfa tous les mois au titre de frais locatifs de ces deux stands, somme que la direction de la structure trouve bien entendu exorbitante compte tenu des revenus générés ou même du but visé par ces boutiques qui au-delà du lucratif est essentiellement
pédagogique. Une situation déplorable qui pousse notre confrère Menoua Actu à cette interrogation : « Comment comprendre donc qu’au moment où l’on s’attend à ce que la Commune de Dschang renforce son appui à cette structure, qu’elle veuille plutôt la spolier davantage mettant en péril la vie des jeunes camerounais qui ne regardent que les revenus générés par ces boutiques. N’est-il pas temps de questionner profondément la compréhension du rôle de ces entités décentralisées dans la mise en œuvre des politiques publiques inclusives impulsées au sommet de l’Etat ? »
Encourager les personnes handicapées à créer des entreprises individuelles et des coopératives
Samuel Fondop, promoteur du Cispam, trouve que la Convention internationale relatives aux droits des personnes handicapées a été violée par le maire de la commune de Dschang. Il brandit aussi le traité de Marakech qui promeut spécifiquement les droits des aveugles et mal voyants. En effet, l’article 26 de ce texte indique : «
1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes :
1. Commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun;
2. Facilitent la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales.
2. Les États Parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services d’adaptation et de réadaptation.
3. Les États Parties favorisent l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l’adaptation et la réadaptation.»
Relativement à la même question, la LOI N°2010 / 002 DU 13 AVRIL 2010. PORTANT PROTECTION ET PROMOTION DES PERSONNES HANDICAPEES est assez édifiantes.
L’article 40 de cette loi précise : « (1) L’état, les collectivités territoriales et la société civile encouragent les personnes handicapées à créer des entreprises individuelles et des coopératives.
(2) l’encouragement des personnes handicapées se fait par : – des facilités fiscales et douanières accordées selon le cas et sur proposition du ministre chargé des affaires sociales. – l’octroi de l’aide à l’installation ; – la mise à disposition des encadreurs techniques ; – les garanties de crédits et l’appui technique des organismes publics au développement, notamment dans le cadre des études et du suivi des projets. (3) Des conventions signées entre les
acteurs visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus et le ministre des affaires sociales déterminent les modalités de leur partenariat. »
Guy Modeste DZUDIE(Jade)